Histoire de l'islam politique en Algérie
تاريخ التيارالإسلامي في الجزائر
L’islam politique en Algérie n’a pas été le fruit d’une génération spontanée. Il a pris racine et s’est développé à partir de plusieurs souches-mères plus ou moins anciennes. Il a commencé par être un état d’esprit, puis une mouvance, avant de se développer en mouvement et de s’organiser en partis.
L’Algérie compte en son paysage politique des tendances islamistes très différentes. Ces tendances sont illustrées par différentes stratégies politiques vis-à-vis de l’État, de la société civile et de partenaires extérieurs.
لم يكن الإسلام السياسي في الجزائر نتيجة جيل عفوي. لقد ترسخ وتطور من العديد من سلالات الأم القديمة.بدأ كحالة ذهنية ، ثم كحركة ، قبل أن يتطور إلى حركة وتنظم في أحزاب.
للجزائر اتجاهات إسلامية مختلفة في المشهد السياسي. وتتضح هذه الاتجاهات من خلال الاستراتيجيات السياسية المختلفة تجاه الدولة ، المجتمع المدني والشركاء الخارجيين.
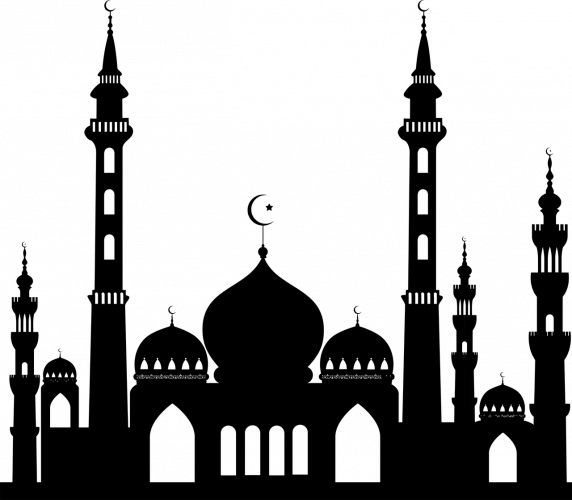
Racine De La Mouvance De L'islam Politique en Algérie
جذر حركة الإسلام السياسي في الجزائر”
Les Sources Endongénes المصادر الداخلية
La première est à rechercher dans la place prépondérante occupée par l’islam dans la superstructure des Etats berbères d’Afrique du Nord du moyen âge, dans l’enseignement et l’exégèse de la culture spirituelle traditionnelle — tendanciellement soufie — missions dévolues à l’un de ses avant postes de médiation sociale les plus influents : les zaouïas.
للحصول على المصدر الأول يبدأ البحث في المكان الراجح الذي يشغله الإسلام في البنية الفوقية للدول الأمازيغية في شمال إفريقيا في العصور الوسطى ، في تدريس وتفسير الثقافة الروحية التقليدية – الصوفية الميلانية – المهام التي انتقلت إلى واحدة من أكثر مواقع الوساطة الاجتماعية تأثيرًا: الزاويات.
La seconde branche généalogique à laquelle se rattache l’islamisme politique algérien est le mouvement de l’association des Oulemas, lancé dans les années 1930 par cheikh Abdelhamid Ben Badis. Les membres de l’association ont puisé leurs connaissances soit en Orient, soit à Tunis.
Partisans d’un grand rigorisme religieux, ils sont affiliés intellectuellement au grand mouvement de la Renaissance Arabe.
الفرع الثاني لعلم الأنساب الذي يرتبط به الإسلام السياسي الجزائري هو حركة جمعية العلماء ، التي أطلقها الشيخ عبد الحميد بن باديس في الثلاثينيات. استمد أعضاء الجمعية معرفتهم إما من الشرق أو من تونس.
مؤيدين للتشدد الديني الكبير ، إنهم ينتمون فكريًا إلى حركة النهضة العربية العظيمة.
La lecture rationaliste de l’Islam proposée par Malek Benabi, Ali El- Hamamy, le Dr Ahmed Aroua et le Dr Taleb Ahmed El-Ibrahimi, disciples de l’Afghan Nedjmeddine Bamatte et du Pakistanais Ali Djinah est, elle aussi, à comptabiliser parmi les contributions à la gestation et à l’agrégation de la mouvance de l’islam politique bien qu’infime et contestée par les orthodoxes.
إن القراءة العقلانية للإسلام التي اقترحها مالك بن نبي ، علي الحمامي ، د. أحمد عروة ، د. طالب أحمد الإبراهيمي ، تلاميذ الأفغاني نجم الدين باماتي والباكستاني علي جينة ، يجب أن يحسبوا أيضًا من بين مساهمات في الحمل وتجميع حركة الإسلام السياسي على الرغم من أنها صغيرة ومتنازع عليها من قبل الأرثوذكس.
La djazaâra (algérianiste) est un courant qui prône un projet politique qui puise ses valeurs dans la profondeur de l’islam algérien et ses spécificités, comprise comme un effort interne d’interprétation du dogme sunnite dans le sens d’un ijtihad national, est également créditée d’une part de paternité dans la constitution de la mouvance, en association avec le réseau caritatif et les tribunes prosélytistes ouvertes dans les innombrables mosquées «libres» du pays.
الجزئرة تعتبر تيار يدعو إلى مشروع سياسي يستمد قيمه من عمق الإسلام الجزائري وخصائصه ، يُفهم على أنه جهد داخلي لتفسير العقيدة السنية بمعنى الاجتهاد الوطني ، كما ينسب إليه نصيب من التأليف في دستور الحركة ، بالاشتراك مع الشبكة الخيرية ومنتديات التبشير المفتوحة في عدد لا يحصى من المساجد “الحرة” في البلاد.
Les sources extérieur المصادر الخارجية
Aux sources endogènes, s’ajoutent celles qui sont à répertorier à l’extérieur :
بالإضافة إلى المصادر الداخلية ، هناك مصادر تُدرج خارجيا:
Le salafisme, un courant qui existait depuis le 14ème siècle, sous l’impulsion d’Ibn Taymiya et son pendant pratique applicatif qui est le Wahabisme, l’oeuvre du théologien et ouléma saoudien, Mohamed Ben Abd Al Wahhab.
Le salafisme et le wahhabisme sont découvert par les Algériens à la faveur de leurs pèlerinages répétés à La Mecque où ils prirent connaissance, en direct, de ce rite rigoriste et spartiate, qui veut revenir aux sources de l’islam, c’est-à-dire qui veut que les musulmans vivent comme les musulmans vivaient au 1er siècle de l’islam. C’est donc un mouvement revivaliste, passéiste, rigoriste, qui s’appuie sur une interprétation littérale du Coran et de la tradition prophétique. Il vise à remettre une société en place musulmane, selon les premiers principes de la religion.
Les frères musulmans, mouvement fondé en 1928 en Egypte par Hassan Al-Banna. Contrairement aux salafistes, les frères musulmans ont islamisé des conceptions politiques occidentales : la formation de partis ou de structures organisationnelles, la participation aux élections, l’accès des femmes à l’espace politique ou professionnel.
Les Frères musulmans prônent un islam globalisant, et veulent peser sur les débats internationaux, et s’attachent à développer un lobby susceptible de faire naître un « vote musulman » dans le monde.
S’il est, incontestablement, établi que la mouvance islamiste ne fut pas une création ex- nihilo, elle ne se distingue pas, non plus, par son homogénéité. Les sources et les apparentements énumérés, ci-dessus, recoupent les diverses tonalités qu’elle étale sur une gamme variée de chapelles qui vont de la plus radicale à la plus «modérée».
Le courant traditionnel, le mystisisme soufi
Les chefs maraboutiques, jadis dépositaires d’une tradition mystique, étaient à la tête des confréries religieuses (zaouiyas). Ces confréries avaient une place important dans la société post coloniale. Ils étaient mis au frigo après l’indépendance, accusés à tort ou à raison d’être la survivance moyenâgeuse et d’avoir servi le colonisateur.
Après une traversée du désert qui durera quelques décennies, toléré sous Chadli, ils sont revenu au devant de la scène politique et social avec l’arrivée au pouvoir de Bouteflika.
Les Oulemas
Les Oulémas sont ces algériens issus d’un savoir lettré acquis dans les zaouiyas algériennes puis en Tunisie et au Moyen-Orient, qui militent pour un islam réformé, épuré des pratiques liées au culte des saints et aux coutumes, pour retrouver le modèle des pieux ancêtres.
Au point de vue dogmatique ils sont disciples de Cheikh Abdo. Leurs mots d’ordre politiques sont pris auprès de Chekib Arslan, le grand organisateur du nationalisme arabe, en même temps qu’auprès d’Amin El Hoseini, l’instigateur du Congrès musulman de Jérusalem. C’est, en effet, à la suite de ce dernier Congrès qu’a été créée en Algérie, à la fin de 1931, l’association des ouléma, sous la direction de Cheikh Ben Badis. Le mouvement réunit des personnalités variées, qui forment, si l’on peut dire, une droite avec le célèbre prédicateur d’Alger, Tayeb el Oqbi, éloquent et conciliant; un centre, avec Ben Badis de Constantine et Bachir Brahimi de Tlemcen, tous deux bourgeois pan-arabes ; une gauche, tendant la main aux communistes ou à l’« Étoile Nord-Africaine », avec le Cheikh Zahiri, d’Oran, et Lamin Lamoudi. A cette pléiade s’ajoute un historien qui célèbre la gloire de la civilisation du Maghreb et l’imperméabilité de la race berbère aux envahisseurs, le Cheikh El Mili.
Après l’indépendance les Oulémas ont joué un rôle clé dans les rouage du pouvoir, soit par la participation direct au gouvernement, ou par la pratique du lobbying auprès des différents Présidents et différentes institutions de l’Etat.
Les réformateurs
C’est le courant qui prônent la réforme et comment faire sortir l’islam de l’impasse pour le remettre dans le sens de l’Histoire. Il vise à élaborer une théorie pragmatique de la réforme de l’islam : pourquoi réformer ? Comment réformer ? Que réformer ? Qui est habilité à réformer ? Autant de questions cruciales que se posent les adeptes de ce courant.
La figure emblématique du courant et le père spirituel, est incontestablement Malek Bennabi. Il est le penseur de la problématique des causes du déclin du monde musulman avec son corollaire les conditions de sa renaissance. Auquel, on rajoute Ali El- Hamamy, Rachid Benaissa, le Dr Ahmed Aroua et le Dr Taleb Ahmed El-Ibrahimi, Abdelkader Boukrouh, Sofiane el Djilali, Fodhil Boumala, et des partis politique comme le PRA de Boukrouh, MAJD de Kasdi Merbah, Djil el Djadid de Sofiane et Djilali.
Les Djaâzaristes (algérianistes)
Les Djaâzaristes est le courant « algérianiste » (de djaza’ir, Algérie) qui a pour ambition de constituer un Etat Islamique spécifique à l’Algérie, sont partisans d’un islam aux couleurs algériennes, par opposition aux «frères musulmans» qui viserait un rayonnement international à partir de l’Algérie ou les salafistes qui veulent un retour à l’islam originel du premier siècle. Le mot djazara est créé par l’islamiste Mahfoud Nahnah pour désigner péjorativement ses rivaux au sein de la mouvance islamiste.
C’est dans les milieux universitaires que le courant des djazaraa’s enregistre ses meilleurs succès, ce qui explique la présence de nombreux diplômés francophones des filières techniques en son sein et sa composante principalement de jeunes scientifiques, venus à la politique par le biais d’un ressourcement et d’un enracinement dans l’Islam. Ils avaient pour doctrine « nulle accession à l’Islam vrai sans sciences exactes » d’une manière générale les sciences molles (Sciences humaines) n’avaient pas, pour les algérianistes, de valeurs et étaient pour la plupart du temps en contradiction avec l’Islam,
Le père spirituel de ce courant est le cheikh Sahnoun. Parmi les personnes connus adepte du courant, on peut citer Mohamed Said, Mohamed Hachani, Mourad Dhina, Anouar Heddam. Le mouvement politique qui l’incarne actuellement est Rachad, de part sa composante.
Les islamistes dit, modérés
Une large part de ceux qui se réclament aujourd’hui de l’islamisme modéré étaient des militants de l’action violente et radicale dans les années 70 et 80, moyen qu’ils estimaient être le seul capable d’établir un Etat islamique dans un contexte de fermeture et de répression politique de toute forme d’opposition. Mahfoud Nahnah, fondateur du mouvement Hamas s’est illustré par des opérations de sabotages dans les années 1976.
Ils sont qualifiés de modérés, pour les différencier de leur frères ennemis les salafistes, avec qui, ils partagent le projet d’instaurer un régime théocratique, mais desquels ils se distinguent par les méthodes utilisés, les références et le discours.
D’un discours révolutionnaire, ils sont passés à des revendications contestataires avant de se muer en pilier conservateur de la société.
Ce courant trouve beaucoup de soutien de gros commerçants sympathisants qui se sont proliféré grâce à la manne financière qu’a connu l’Algérie à partir de la fin des années 90 et les années 2000.
Ils sont membre de l’internationale islamiste et proche des frères musulmans égyptiens. Ils sont sur la lignée du modèle du parti islamiste turc de l’AKP, actuellement au pouvoir, où on observe un éloignement d’une utopie révolutionnaire au profit d’une vision plus efficiente, où l’argent a largement remplacé les idées dans leur défense de l’islam. Il faut donc noter aussi l’émergence d’un nouveau type de militant islamiste répondant à la figure de « l’entrepreneur », remplaçant de plus en plus la figure du leader associatif reconvertit en leader politique.
Ils ont fait évoluer aussi leur discours en délaissant le religieux pour des thématiques plus politiques et profanes.
Ce courant est représentée actuellement dans la scène politique par le Mouvement de la société pour la paix (HMS), le Mouvement pour la réforme nationale (El Islah) et le Mouvement de la renaissance islamique (Ennahdha), regroupée un moment dans l’alliance pour une Algérie verte. Auquel on rajoute le TAJ de Amar Ghoul.
Les salafistes
Le salafisme algérien s’est lié au salafisme venu d’orient et son pendant le wahhabisme saoudien depuis plus d’un siècle, en plusieurs étapes. Il est sont leur agent local dont la mission est de répandre le discours de l’extrême droite du courant islamiste.
Ça a commencé avec l’association des Oulemas ou le prédicateur d’Alger, Tayeb el Oqbi, qui militait pour restaurer l’Islam dans sa pureté primitive, était le représentant le plus fidèle.
Après l’indépendance, les filiations avec le salafisme sont établies au sein de l’Association des Oulémas musulmans au travers de trois figures décisives de passeurs – celles de Omar Arbaoui, de Abdellatif Sahraoui principalement, et subsidiairement celle de Ahmed Sahnoun – héritières du wahabisme d’El Okbi.
Dans les années 1980, les « mosquées libres » deviennent « un espace de parole et de diffusion de l’islam radical, beaucoup étaient tenu par les imams salafistes. Après l’ouverture en 1988, une partie de la composantes et des leaders du FIS etaient des salafistes.
Ce courant a largement progressé au sein de la société ces dernières années avec le consentement du pouvoir. L’un des prédicateurs largement médiatisé de pars ses fetwas est Mohamed Ali Ferkous, connu pour avoir toujours été le guide spirituel des salafistes dits «madkhalistes» en Algérie. Auquel on rajoute le Front pour l’éveil islamique, un parti non agréé dirigé par l’ancien militant du FIS Abdelfattah Hamadache ;
Evolution post indépendance
Références bibliographiques
المراجع الببليوغرافية
- L’opposition politique en Algérie : racines et projections. Badr’eddine Mili. Edition Casbah, 2017
- L'Algérie par ses islamistes. Par Mustafa al-Ahnaf, Bernard Botiveau et Franck Fregosi. Edition Karthala. Année : 1991
- Les salafistes algériens désorientés. El Watan, 02 novembre 2017.
- La naissance du Front islamique du salut : une politisation conflictuelle (1988-1989) Myriam Aït-Aoudia Dans Critique internationale 2006/1 (no 30), pages 129 à 144
- Les partis islamistes du Maghreb et leurs liens avec l'Europe: Influences croisées et dynamiques de démocratisation Amel Boubekeur Amel Boubekeur. Octobre 2006.
- L'Algérie et la démocratie, pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contemporaine. Lahouari ADDI, édition el Maarifa, 2014
- Algérie, la guerre des ombres. Youcef Zirem. Editions COMPLEXE, 2002. (1)
Publications du même thème
D'autres articles
© 2019, Prisma All Rights Reserved.
