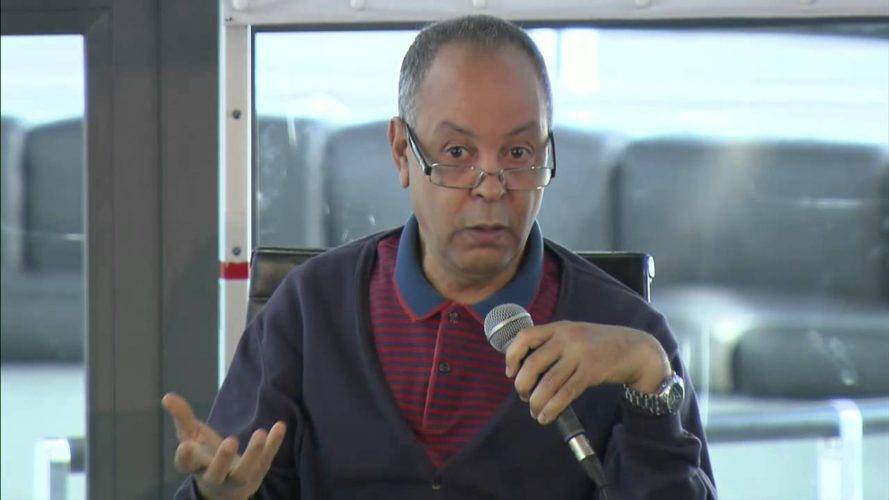Ceux qui, depuis le déclenchement du mouvement du 22 février, s’en prennent aux femmes pour les faire taire devraient savoir que si elles obéissaient aux injonctions qui leur sont ainsi faites de ne pas se mêler de politique, cela entraverait leur propre exercice de la politique.
Car il n’y a aucune citoyenneté qui puisse s’exercer pleinement sans elles. Non parce qu’elles sont des femmes, mais parce qu’elles sont des sujets politiques comme le sont ou pourraient l’être les hommes.
Il est difficile de faire comprendre à des hommes hostiles politiquement et religieusement aux femmes et à leur présence dans l’espace public qu’il n’y a dans ce dernier ni hommes ni femmes mais uniquement des personnes (ashkhasse) qui exercent leur droit en connaissance de cause autant pour s’affirmer individuellement, en tant que sujets autonomes doués de raison et aptes à exercer leur esprit critique, que pour s’affirmer comme une part constitutive de l’ensemble des citoyens qui forment le peuple.
Or, le peuple, s’il est une réalité multiple par sa diversité et par les autres différences qui le traversent y compris sexuelles, il est un en tant corps politique. Ils l’ignorent, mais les hommes hostiles aux femmes attentent à leur propre statut politique. Ils empêchent le peuple de se constituer dans sa complétude. Ils ne veulent pas être heureux.
Car celui qui empêche quelqu’un d’autre heureux est lui-même malheureux. Et si l’on est malheureux, comment peut-on prétendre devenir un être politique ? Car la politique n’est rien d’autre que le moyen par lequel chaque peuple, dès lors qu’il a acquis statut de corps politique, d’accéder au bonheur. Or, les femmes ont plus de raisons que les hommes pour se défendre et pour obtenir des droits que souvent les hommes n’ont même pas eu à revendiquer et encore moins à exiger.
Il en est ainsi de l’égalité civique. En la revendiquant dans son intégralité, elles font preuve de civisme et de maturité politique.
Car elles savent qu’un corps politique mutilé est un obstacle à l’émancipation de tous. Puisque l’on ne peut être libre en associant la liberté à certains visages à l’exclusion d’autres.
Le déchaînement des réseaux sociaux contre les femmes revendiquant l’égalité des droits, à mesure que le mouvement du 22 février est monté en puissance, a trouvé un soutien actif auprès de quantité de femmes convaincues que c’est par devoir religieux qu’elles agissent.
C’est là une des plus grandes supercheries que ceux qui veulent que les femmes demeurent entravées et réduites au statut d’animaux domestiques, quand eux prétendent être des animaux politiques, ont inventée. Religieusement, l’islam n’a pas exclu toute égalité entre hommes et femmes.
Certes, tous les ulémas n’admettent pas que la femme soit juge, imam ou souverain, mais tous sont d’avis que le statut de «compagnon» (ahāb) a bien été défini en dehors de toute considération ethnique ou sexuelle. Les ulémas les plus traditionalistes, tels Al Bukhari, sont eux-mêmes convenus que quiconque a vu ou entendu le Prophète parmi les musulmans a rang de «compagnon».
Or, il n’échappe à personne que beaucoup de femmes ont accédé à ce statut. Et lorsqu’elles ont été reconnues comme telles, elles ont obtenu le même statut que les hommes. Cette forme d’égalité a eu des conséquences majeures dans la transmission de la foi.
D’abord parce que les «compagnons» ont un statut dogmatique qui en fait des modèles d’exemplarité religieuse, ensuite parce que les chaînes de transmission de la foi n’ont pas exclu les femmes de leurs maillons. Les musulmans des premiers temps sont allés plus loin puisqu’ils ont admis que toute femme, dès lors qu’elle était «digne de foi» (thiqa), pouvait être transmetteuse de traditions prophétiques, c’est-à-dire participer à la production du dogme.
On n’en demandait pas plus aux hommes. Les musulmans pieux, qui ne manipulent pas leur religion à la seule fin d’en faire un instrument d’oppression des femmes, le savent si bien qu’ils donnent à leurs mosquées des noms de femmes des premiers temps de l’islam choisies parmi les «compagnonnes» mais également les grandes saintes.
D’aucuns diraient que si tel est le cas, autant revenir à la religion pour fonder un espace politique. Là encore, il s’agit d’une mystification.
Aucune institution politique en islam n’a un contenu et une forme à caractère religieux. Pas même le califat n’en est pas une. Dans le cas contraire, les premiers souverains musulmans se seraient naturellement désignés califes. Mais ce n’est pas ce qu’ils ont fait. Dans les documents officiels qu’ils ont laissés, ils n’ont revendiqué que le titre de «prince des croyants» (amir al-mu’minin). Ils auraient certes pu choisir de dire qu’ils étaient les «princes des musulmans».
Aussi étrange que cela puisse paraître, les musulmans du premier siècle de l’hégire ne se désignaient pas encore comme tels, mais uniquement comme des croyants, sans doute pour laisser ouvert le concept de croyance, qui n’en est venu à se rétrécir par la suite que sous le poids de circonstances toutes frappées au coin de la détermination historique.
Aussi bien l’institution dite califale n’était rien d’autre qu’une institution étatique comme les autres, constituée sur le modèle impérial des Sassanides et des Byzantins auxquels elle a emprunté ses pratiques gouvernementales et administratives ainsi que son étiquette de cour.
Le mot «dīwān» désignant l’appareil étatique des premiers musulmans est lui-même d’origine persane. Les Hedjaziens, peuple de Muḥammad, qui n’avaient pas de traditions politiques propres à eux, ont choisi les meilleures que les deux plus grandes superpuissances de l’époque leur ont donné à admirer et à éprouver, alors même qu’ils les combattaient pour à leur tour fonder une puissance impériale qui soit le symbole de la suprématie arabe.
Autres temps, autres mœurs. Aujourd’hui, les moyens politiques les meilleurs sont ceux qu’offrent la démocratie, qui n’est pas plus impie que ne l’était la commanderie politique d’origine perso-byzantine adoptée par les premiers musulmans. Aujourd’hui, les Algériens sont les citoyens d’une République que personne, en dehors d’une minorité qui trafique la religion, ne cherche à changer.
Or parce qu’elle se définit constitutionnellement comme «démocratique» et «populaire», la République algérienne – prenons-la au mot ! – repose sur un principe théorique simple, qui est que «je ne peux être un citoyen si un autre citoyen que moi est privé de ce statut ou s’il ne lui est accordé que passablement».
Disons-le clairement : dès que ceux qui attentent au sacré du Coran en le profanant pour en faire une soi-disant Constitution veulent transformer la politique en «politique religieuse» (siyāsashar‘iyya), selon les mots d’Ibn Taymiyya leur grand doctrinaire, ils deviennent aussi oppressifs que les dictatures prétendument laïques qui ont sévi ou sévissent encore dans le monde arabe. De ces deux politiques de la tyrannie, il n’y a que la démocratie qui nous sauvet.
Il est si grand qu’un philosophe arabe a pu dire, en évoquant les Etats qui déconsidèrent les femmes, que «dans [tels] Etats, les capacités des femmes ne sont pas reconnues, car elles ne sont utilisées que pour procréer.
Elles sont donc mises au service de leurs maris et [confinées] à la procréation, à l’élevage [de leurs enfants en bas-âge] et à l’allaitement. Mais cela annule leurs (autres) activités. Parce que les femmes dans ces Etats ne sont préparées à aucune des vertus humaines, il arrive souvent qu’elles ressemblent à des plantes».
Ce philosophe n’est pas notre contemporain, il a vécu en Al-Andalus au XIIe siècle, et il s’appelle Ibn Rushd. Pourtant, sa description aurait pu figurer dans le «rapport arabe sur le développement humain de 2002» qui, tout en saluant les progrès réalisés en matière d’éducation féminine dans le monde arabe, note, désabusé, que «malgré ces progrès, on constate la persistance d’attitudes et de normes sociales fondées sur le sexe, qui ne voient que le rôle procréateur des femmes» (p. 15).
Qu’on ne s’étonne pas que le développement s’obstine à déserter nos contrées pendant que certains se posent encore doctement la question de savoir «pourquoi les Arabes ont accusé du retard pendant que les autres prenaient de l’avance ?» Il n’y a pas de mystère.
Toutes les enquêtes internationales sur le développement social le prouvent, les pays multiplient d’autant leur chance de se développer et de prospérer qu’ils pratiquent l’égalité homme/femme.
Mais elles témoignent aussi et surtout qu’il n’y a aucun pays où les femmes ont accédé à cette égalité sans volonté politique forte. Ou ce qui revient au même : sans combat.
Que l’on ne s’imagine pas que les femmes algériennes ont démérité. Elles sont au cœur de la constitution de la nation algérienne en tant que corps politique national depuis ses premiers balbutiements.
Cet événement fondateur a un lieu et une date : Alger, le 14 juillet 1937. Le leader historique de l’indépendantisme algérien, Messali Hadj qui l’a consigné dans ses Mémoires, en a conservé sa vie durant un souvenir impérissable.
Voici ce qu’il en dit dans ses Mémoires : «[…] Notre cortège augmente en nombre à la vue du drapeau vert de l’Islam et du drapeau algérien. Femmes, hommes, jeunes gens, jeunes filles se joignent à nous et chantent le chant national du PPA, tandis que les femmes lancent des youyous qui grisent les Algériens qui pour la première fois assistent à une telle manifestation.
Les mots d’ordre du parti ‘‘Vive le PPA’’, ‘‘Vive la liberté, la démocratie’’, ‘‘Vive l’indépendance de l’Algérie’’, ‘‘Vive l’Islam’’ sont lancés tout le long du parcours. Quand le cortège a atteint la préfecture, les foules ont crié ‘‘A bas le code de l’Indigénat, et les lois d’exception’’, ‘‘Vive la démocratie et l’émancipation du peuple algérien’’.
Algériens et Algériennes sautaient sur le drapeau pour l’embrasser, puis ils priaient et poussaient des cris de joie et des youyous […]» (Mémoires manuscrits, Cahier n° 10, p. 5719-5725).
Jamais les Algériens n’étaient, avant ce 14 juillet 1937, descendus en si grand nombre dans la rue pour, de surcroît, exprimer des opinions politiques radicales. Ce jour-là, ils ont envahi la rue jusqu’à provoquer le phénomène de morphologie politique le plus impressionnant que la colonie ait jamais connu. Toute aussi inédite et surprenante est la sociologie de cette action collective qui a introduit dans le contexte de l’Algérie musulmane la question du genre en politique.
Après avoir concerné les hommes, la politisation a affecté les femmes algériennes, jusqu’à les conduire à faire une irruption remarquable dans l’espace public. Mais ce n’est pas la première fois que les femmes en sont venues à l’action politique publique ; elles avaient déjà manifesté leur présence au grand rassemblement du Congrès musulman algérien organisé le 2 août 1936 au stade municipal d’Alger.
Quelques jours auparavant, déjà, elles étaient nombreuses au défilé du 14 juillet. Déjà au congrès du 2 août, Messali, qui y avait prononcé son premier discours politique en Algérie, avait salué «leur présence à laquelle personne ne semblait avoir prêté attention» – Comme si elles étaient invisibles.
Les femmes algériennes sont une histoire du combat pour l’émancipation de leur pays couplée à la leur doit être écrite afin de ne rien perdre de sa substance. Sans quoi on en viendrait à oublier que ce qu’elles ont obtenu elles l’ont arraché de haute lutte.
Or, le premier droit qu’elles ont conquis d’elles-mêmes est leur présence aux côtés des hommes dans les grandes manifestations de masse. Intuitivement, elles ont compris que faire de la politique ne s’effectue pas sans disposer des conditions de sa propre visibilité sociale. Autrement on n’existe pas, du moins en tant qu’acteur agissant déterminé à changer le cours des choses.
Et pour l’affirmer, elles ont dû braver les tabous sociaux de leur propre communauté avant de défier les interdits coloniaux qui, de toute évidence, frappaient tous les Algériens musulmans sans distinction.
Bref, les exemples sont multiples qui attestent de la légitimité historique de leur combat. C’était hier. Aujourd’hui, le combat est démocratique.
Que par-delà leurs convictions les femmes s’en approprient, c’est notre quête du bien commun à tous qui l’exige. Qu’elles parlent, qu’elles témoignent, qu’elles éclairent, qu’elles guident. Nous avons besoin de leur force autant pour pallier nos faiblesses que pour surmonter nos failles.